Le lundi 20 Octobre 2025 dès 10h s’est ouvert l’atelier organisé par AFSA pour outiller les représentants des organisations paysannes venus de 10 pays d’Afrique Centrale sur un instrument en cours d’adoption le protocole sur les droits de propriété intellectuelle de la Zone Africaine de Libre Echange (ZLECAF), le système multilatéral (MLS) défini par le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture (TIRPAA), le mécanisme d’Accès et de Partage des Avantages (APA) du protocole de Nagoya et les Informations sur le Séquençage Numérique (ISN). L’atelier qui s’est déroulé durant deux jours dans la salle de conférence de l’Hotel Paradisia de Cotonou avait pour objectif de renforcer les connaissances et les capacités de plaidoyer des organisations d’agriculteurs afin qu’elles puissent s’engager de manière éclairée et significative sur ces instruments et processus.
La première journée de l’atelier a débuté par l’accueil et l’installation de la trentaine de participants présents dans la salle, suivi d’un mot d’ouverture de M. FAMARA, coordonnateur de programme dans l’organisation AFSA en charge de l’organisation de l’atelier, et le mot de bienvenue de M. Patrice SAGBO qui a joué un rôle important de facilitateur pour la logistique. Par la suite, la parole a été donné à un responsable du Ministère de l’environnement du Bénin, Point Focal honoraire Bénin du TIRPAA pour le mot d’ouverture et de lancement officiel de l’atelier. Une fois le programme validé par tous les participants, on a procédé à la traditionnelle photo de famille suivi de la pause déjeuner.
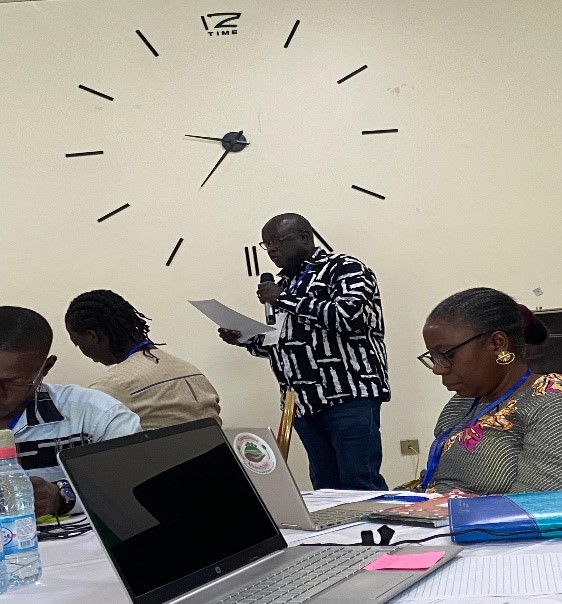

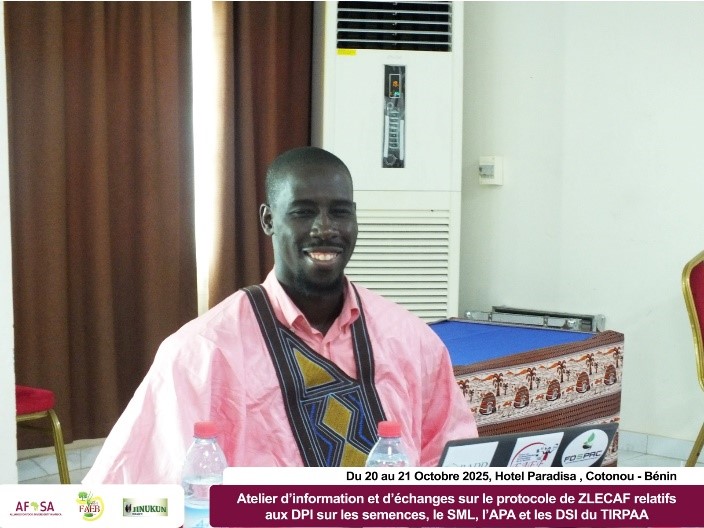
De retour de la pause, les travaux ont pu débuter avec la première présentation de M. FAMARA sur les implications de la ZLECAF pour les systèmes semenciers paysans et la souveraineté alimentaire en Afrique.
La présentation s’adossait sur un rapport de AFSA publié en août 2024 intitulé « déballage du protocole de la ZLECAF sur les Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) ». En résumé, la ZLECAF dont le texte a été ratifié par 54 Pays Africains est entré en vigueur le 21 mars 2018. Elle vise à stimuler le commerce intra-africain et la transformation économique à travers la création d’un marché unique de biens et de services libéré des droits de douane et des barrières non tarifaires. Un tel marché représente une opportunité pour l’agriculture africaine car selon les prévisions, elle pourrait permettre de stimuler les échanges intra africain dans le marché agricole de 574% d’ici 2020, favoriser un marché unifié pour les intrants agricole et booster la recherche et le développement dans le domaine de l’agroécologie. Cependant de nombreux risques demeurent et génèrent des craintes pour les systèmes semenciers paysans et la souveraineté alimentaire en Afrique. Il s’agit de l’absence de cadre juridique unifié qui promeut et protège les droits des paysans sur leurs semences dans les pays africains, de l’absence d’un régime commercial simplifié et surtout adapté aux petits exploitants agricoles.
Pour ce qui est du protocole DPI, dans un sens, il représente une opportunité car il pourrait offrir plus de choix aux agriculteurs en termes de semences, sauvegarder les savoirs traditionnels associés aux semences paysannes, et renforcer le système de protection des semences et la souveraineté semencière puisqu’il oblige les obtenteurs à divulguer l’origine du matériel génétique qu’ils ont exploité. Cependant compte tenu du fait que l’Union de Protection des Obtentions Végétales et par extension l’ARIPO et l’OAPI ont largement façonné ce protocole, il est possible d’envisager qu’il va plus favoriser les entreprises semencières que les paysans. Ce d’autant plus que le protocole ne définit pas de manière précise les droits des paysans, ne les protège pas contre la biopiraterie et ne prévoit pas suffisamment de mécanismes de recours pour les communautés et les petits exploitants agricoles en cas de violation de leurs droits.
A la suite de M. FAMARA, le Dr. Mame Codou GUEYE, Chercheure à l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) a fait une présentation sur la signification du protocole de la Zlecaf sur les DPI en matière de semences et résultats des consultations au Sénégal.
Le Dr GUEYE a introduit son propos en présentant de manière sommaire le système semencier du Sénégal qui est constitué à 80% de semences paysannes. Elle a rappelé l’importance des semences paysannes pour la souveraineté alimentaire et l’identité culturelle des communautés mais elle a pointé du doigt le fait ces semences sont exclues du cadre juridique défini par la Loi N°94-81 du 23 décembre 1994, relative à l’inscription des variétés, à la production, à la certification et au commerce des semences ou plants et ses trois décrets d’application (tous en date du 17 juin 1997) qui s’arriment à la règlementation de l’UEMOA et de la CEDEAO en la matière (resp. C/REG.4/05/2008, N°3/2009/CM/UEMOA), l’UPOV et l’OAPI avec le protocole DHS. Fort de ce constat et du fait pour que les semences paysannes passent d’un marché de niches à un marché industriel, elles doivent remplir des critères de qualité, elle a insisté sur l’importance de les identifier, caractériser et cataloguer selon un processus scientifique rigoureux. C’est dans ce sens que l’ISRA a entamé une étude visant à procéder au catalogage des semences paysannes suivant le protocole DHS défini dans la loi et approuvé par l’UPOV. Les expérimentations sur deux espèces, le fonio et l’aubergine africaine ont démontré que ces espèces sont distinctes, présentent une certaine homogénéité et elles sont stables. Le Dr a conclu qu’il est parfaitement possible d’inscrire les semences paysannes dans le même catalogue que les semences certifiées ce qui a suscité de vives réactions lors des échanges beaucoup estimant que c’était un peu plus déposséder les communautés locales de leurs semences. De manière générale, la création d’un système de d’identification, de caractérisation et de catalogage propre aux SSP a été beaucoup évoqué par l’assistance.
Par la suite, les participants ont pu également s’exprimer sur la proposition de AFSA en ce qui concerne le protocole ZLECAF avant de se rendre à la pause. Elle s’articule en 5 points : la Reconnaissance des droits des agriculteurs au même titre que ceux des obtenteurs ; la préservation de la souveraineté des États et la protection des pays les moins avancés (PMA) ; l’inclusion des variétés paysannes et locales dans le système de protection (le point le plus contesté car il s’agit de s’arrimer au système UPOV) ; la limitation des restrictions et des sanctions à l’encontre des agriculteurs ; la transparence, le partage des avantages et la protection des savoirs traditionnels.
L’après-midi a été particulièrement chargée avec trois présentations successives. La première était une présentation par visioconférence du Dr. SOULAMA Soungalo sur le TIRPAA et les enjeux du Système Multilatéral (SM). Elle a été difficile à suivre en raison des lenteurs de la connexion internet qui ont affecté la qualité de la visioconférence toutefois il en ressort les éléments suivants :
- Le système multilatéral du TIRPAA ne concerne que les Ressources Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture (RPGAA) et repose sur l’interdépendance entre les parties à l’échelle nationale comme internationale.
- Il met en commun 64 espèces dont 35 cultures et 24 fourrages définies à l’annexe 1 du TIRPAA.
- L’accès aux ressources génétiques est facilité à travers le SM par deux instruments : l’Accord Type de Transfert de Matériel (ATTM) et l’Accord de transfert de Matériel (ATM).
- Le système multilatéral est en voie d’amélioration. Un groupe de travail a été créé dans ce sens pour « instaurer une sécurité juridique, une simplicité administrative et une transparence pour tous les participants au Système multilatéral »
- Ce groupe de travail s’est penché sur trois aspects : l’extension de l’annexe 1 du TIRPAA, la structure et le barème des paiements et l’Information de séquençage numérique.
L’intervention du Dr. a fait l’objet de quelques questions mais a dû être écourtée en raison des lenteurs de la connexion internet.
Le COPAGEN, représenté par Jean Paul SIKELI de la Côte d’ivoire, a une présenté sur les enjeux du mécanisme d’accès et de partage des avantages du protocole de Nagoya.
Les ressources génétiques sont vitales pour l’agriculture et toutes les activités apparentées. Elles sont liées à la culture et l’histoire des peuples. Avant la Convention sur la Diversité Biologique, les ressources génétiques faisaient partie du patrimoine commun de l’humanité ce qui rendait leur accès libre et empêchait tout partage éventuel des avantages. Cela a été formalisé dans un texte non contraignant de la FAO intitulé l’engagement international, et a fait l’objet de tensions entre les pays du Nord utilisateurs et les pays du Sud détenteurs ressources génétiques. La CDB est venue marquer un changement majeur en proclamant la souveraineté des Etats sur leurs ressources génétiques. Elle reconnait également le rôle capital des communautés autochtones et locales sur la préservation des ressources génétiques et l’importance de valoriser les savoirs traditionnels. La CDB poursuit globalement trois objectifs : Conservation, utilisation durable des ressources et le partage juste et équitable des avantages (APA).
C’est ce dernier objectif qui justifie l’adoption du protocole de Nagoya qui vise à faciliter l’accès aux ressources génétiques au profit des chercheurs et autres sélectionneurs en quête de matériel génétique et garantir le partage juste et équitable des avantages qui découlent de leur utilisation. Concrètement le partage définit la relation entre l’utilisateur et le fournisseur. Pour exploiter le matériel génétique l’utilisateur doit obtenir Consentement préalable et éclairé donné en connaissance de cause qui prends la forme d’une autorisation délivrée par l’Etat. Par la suite, il doit convenir avec les communautés de Conditions Convenues d’un Commun Accord pour le partage juste et équitable des avantages générés à partir de cette utilisation. Ces avantages listés dans le protocole de Nagoya, peuvent être d’ordre monétaires comme non monétaires. Pour le formateur, les enjeux liés au mécanisme APA peuvent bénéfiques (Partage des redevances, le transfert de technologies, l’utilisation durable des ressources génétiques) mais ne sont pas à l’avantage des pays africains pour les raisons suivantes :
- Obstacles liés à la capacité limitée des communautés autochtones et locales : marginalisation des communautés dans les processus de prise de décision, manque d’information à une information claire, documentation non accessible pour des raisons de langue,
- Faible capacité institutionnelle des Etats
- Risques de biopiraterie car le champ du protocole de Nagoya est très large
Pour conclure, L’APA est l’officialisation de la marchandisation du vivant. Il fonctionne comme un couteau à double tranchant. Ce qui pose de nombreuses questions quant à sa pertinence au niveau africain. Doit-on valider ce mécanisme en Afrique au vu des déséquilibre dans les rapports Nord-Sud ? peut-on les sacrifier sur l’autel du libre-échange ?
Pour le COPAGEN, les autorités des pays africains doivent assurer la préservation des ressources génétiques par des lois. Elles doivent exploiter l’ouverture de l’accord de Marrakech pour définir des systèmes de protection de ressources génétiques adaptées à nos valeurs. Elles doivent investir dans la recherche et développement au profit des CAL, dans la dynamique des rapports Sud-Sud.
Les réactions ont surtout souhaité relever le fait que le mécanisme APA n’est pas dénué d’intérêt pour les Etats Africains. Le problème se situe surtout au niveau de la disponibilité des fonds destinés au partage des avantages et de la redistribution équitable de ces avantages aux communautés.
La dernière présentation de la journée a été effectué par M. SILGA Lucien Omer Wendyahoda, du Burkina Faso. Il a entretenu l’assistance sur les enjeux sur les Informations de Séquençage numérique (DSI).
L’ISN (DSI) provient de la numérisation de l’information contenue dans le matériel génétique des organismes vivants (plantes, animaux, micro-organismes, etc.). Cette information correspond aux séquences d’ADN, d’ARN ou d’acides aminés, traduites en données numériques à l’aide de techniques de séquençage. Cette technique présente plusieurs enjeux au niveau scientifiques et technologiques ; économiques et stratégiques ; juridique et éthique ; politiques et géopolitiques.
- Au niveau scientifique et technologique les ISN favorisent le progrès scientifique et technologique à travers l’accélération de l’innovation et le partage des données ;
- Au niveau économique et stratégique, elles entrainent une concentration du pouvoir technologique entre les mains des pays du Nord, la création d’un marché international de données génétiques et l’érosion du partage des avantages ;
- Au niveau juridique et éthique, les ISN évoluent en l’absence de véritable régulation internationale ou nationale ce qui peut avoir un impact négatif sur les droits des agriculteurs et des communautés locales.
- Au niveau politique et géopolitique, des tensions existent entre le Nord qui souhaite exclure les ISN de la CDB, et des mécanismes APA et le Sud qui souhaite qu’elles en fassent partie.
Pour SILGA, il faut une refondation du droit international de la biodiversité en définissant le statut juridique des ISN et une mise en œuvre des recommandations de la COP16 de la CDB en novembre 2024, qui avait abouti à l’adoption les modalités de mise en œuvre du mécanisme multilatéral de partage des avantages découlant de l’utilisation de l’information de séquençage numérique et du fonds y afférent dénommé fond Cali. Par ailleurs, Il faut que les Etats africains garantissent leur souveraineté sur ces données par la création des infrastructures adaptées de stockage et de séquençage des données et la maitrise de ces nouvelles technologies.
Les réactions, nombreuses malgré l’heure tardive, ont essentiellement porté sur l’urgence de se positionner en ce que concerne cette technologie qui représente un risque pour les droits des paysans et des communautés sur leurs semences étant que nos Etats n’en auront pas la maitrise et que le cadre international restera flou.
Avec cette dernière présentation s’est achevée la première journée d’atelier, extrêmement enrichissante.
Journée de clôture
La deuxième et dernière journée de l’atelier était consacrée aux actions à mener au niveau national et international. Elle a débuté par un partage d’expérience des points Focaux TIRPAA du Cameroun, du Niger et du Bénin sur ce qui se passe lors des réunions internationales. Ils ont surtout mis en avant le manque de préparation des Etats pour la participation à ces réunions internationales, le manque de ressources allouées aux points focaux que ce soit au niveau international ou au niveau national et les difficultés pratiques qu’il rencontre lors des négociations.
Par la suite, les participants ont été divisé en groupe de travail constitué selon la nationalité des participants. Ainsi nous avons rejoint le groupe composé des participants venus du Cameroun, du Tchad et de la République Centrafricaine, soit 5 personnes. Comme souvent nous avons été désignés rapporteur du groupe et les échanges ont duré 40 minutes.
Ci-dessous les résultats du groupe de travail qui ont été présenté et dont la majeure partie a été approuvé par AFSA et les autres participants.
| Pays | Situation-s à changer (problème-s) | Objectif-s | Activités | Responsable (s) |
| GROUPE CRT | ||||
| Cameroun, République Centrafricaine et Tchad | Protocole DPI : Le monopole du système UPOV, ARIPO dans le marché de la ZLECAFLes dysfonctionnements de l’intégration sous-régionale | Protocole DPI : La promotion et la protection des systèmes semenciers paysans et l’équité dans les échanges au niveau sous-régional | Protocole DPI : Mettre en place des cases de semences paysannes et les banques de semence (a minima au niveau national)Organiser des foires semencières Mettre en place de comités paysans d’identification, de caractérisation et catalogage des semences Créer une base de données sécurisée sur les savoirs traditionnelles | RADD, PROPAC, AFSA, SWISS AID, PF TIRPAA (en appui), PF ZLECAF |
| MLS TIRPAA : La méconnaissance du MLS par les principaux acteurs (chercheurs, paysans) L’absence de répertoires actualisés des RPGAA disponiblesManque d’infrastructures de conservation (promouvoir les banques de semences communautaires et nationales)Faible partage des informations (traité et MLS) Le manque de financement (pour mener des actions communes et efficaces)Faible collaboration des administrations avec les organisations de la société civile et les communautés locales à la base Absence de mesures nationales pour la mise en œuvre du MLS | MLS TIRPAA Objectif 1 : Mettre en place des mécanismes de vulgarisation du TIRPAA (réunions, rapports, études, articles etc) Organiser les campagnes de sensibilisation auprès des instituts de recherche Objectif 2 : Plaider pour l’opérationnalisation du poste de point focal Objectif 3 : Organiser des rencontres de concertation des acteurs impliqués dans la gestion des RPGAACréer de plateformes et de réseaux nationaux et sous régionaux Plaider pour la révision des lois semencières | PF TIRPAA, RADD, PROPAC | ||
| APA NAGOYA Manque de clarté du mécanisme de partage des avantages Faible mise en œuvre globale du protocole au niveau national Manque d’efficacité du mécanisme de partage des avantages | APA NAGOYA Objectif 1 : Plaider pour la concrétisation des droits des paysans dans le cadre de l’APA (Campagne de sensibilisation, point presse etc.) Objectif 2 : Organiser des réunions avec les administrations pour attirer leur attention sur l’importance de définirdes mesures nationales (étude, rapports) | RADD, AFSA | ||
| DSI Organiser des sessions de formation à l’attention des administrations concernées sur l’INS et ses enjeux Encourager l’orientation de la recherche vers les DSI | RADD, PROPAC, PF TIRPAA (En appui) | |||
| DSI L’absence d’infrastructures de stockage et de séquençage Transfert de technologie inexistant Manque de financement par les EtatsCadre juridique non opérationnel Manque d’expertise dans le domaine | MLS TIRPAA Objectif 1 : Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des acteurs Objectif 2 : Améliorer le mode de fonctionnement des points focaux Objectif 3 : Renforcer l’implication des institutions concernées dans la mise en œuvre du TIRPAA | |||
| APA : Objectif 1 : Améliorer le mécanisme de partage des avantages Objectif 2 : Encourager les Etats à définir des mesures nationales APA | ||||
| DSI : Encourager les Etats à investir dans l’INS | ||||
Suite au passage de tous les groupes, la cérémonie de clôture a pris le relais avec les mots de M. FAMARA, de M. SAGBO, du Point Focal du TIRPAA Bénin, et de Mme. La représentante du Ministre du Commerce du Bénin pour marquer la clôture effective des travaux.
Le reste de la journée libre a été ponctuée par la visite de la place de l’amazone et un diner dans un restaurant proposant uniquement des spécialités culinaires à base de poissons.
Bilan et recommandations
La participation à l’atelier de renforcement des capacités des organisations paysannes sur le protocole annexe de la ZLECAF relatif aux Droits de Propriété Intellectuelle (DPI), au Système Multilatéral (MLS), à l’accès et au partage des avantages (APA) et aux informations sur le séquençage numérique (INS) a été un moment de découverte, de partage, d’échange et de gain d’expérience. Nous en retirons du positif pour la reconnaissance des systèmes semenciers paysans et la souveraineté alimentaire en Afrique. Il faut impérativement :
- Intégrer le plan d’action de l’atelier au plan d’action du RADD sur la souveraineté alimentaire ;
- Vulgariser le protocole DPI, le SM du TIRPAA, le mécanisme APA du protocole de Nagoya et les ISN à travers des publications et des podcasts ;
- Réfléchir au positionnement stratégique du RADD pour chacun de ces instruments en résonance avec AFSA ;
- Favoriser la synergie entre les participants à cet atelier.


Laisser un commentaire